

 |
 |
|
La méthode du portrait-robot
dans la recherche d'Alésia |
L'argument onomastique est, au fond, ce qui a donné le branle à l'identification d'Alésia.
Au XIXe siècle, la Commission de Topographie des Gaules n'a envisagé qu'un choix possible entre Alaise dans le Jura et Alise en Bourgogne et, après avoir éliminé Alaise, a conclu qu'Alise était Alésia. Cent ans après, Carcopino s'en est tenu à l'opposition Alise-Alaise. La raison toponymique avait paru souveraine.
Contre ce postulat, on peut faire valoir deux remarques.
La première, c'est que la perpétuation d'un nom de lieu n'est pas la règle. "Un nom de lieu se meurt lentement quand la localité à laquelle il était attaché a elle-même disparu" a écrit Paul Lebel, et le souvenir même de ce nom peut s'effacer à jamais: "Ainsi une forteresse hallstattienne, où vivait, six siècles avant notre ère, la princesse de Vix, a-t-elle perdu son nom proto-historique et n'est-elle plus connue aujourd'hui que sous la dénomination banale de montagne de Vix, parce que le village qui se trouve au pied de cette éminence se nomme Vix". Et pourtant, c'est sur la montagne que se trouvait la forteresse; et elle avait un nom. Marcel Baudot a analysé les causes de l'abandon de certains oppida "dont les avantages militaires perdaient de leur importance avec la paix romaine... raison d'ordre politique aussi, conduisant l'occupant à écarter la population indigène de centres de cultes religieux susceptibles de servir de base à des insurrections".
Sur vingt-sept localités mentionnées par César en Gaule indépendante, six ont conservé leur nom au cours des âges: ce sont Bibracte (Mont Beuvray), Cabillonum (Chalon), Decetia (Decize), Matisco (Mâcon), Meclodunum (Melun), Vesuntio (Besançon). Six autres ont changé de nom pour prendre celui de la cité: Agedincum = Sens (Senons), Avaricum = Bourges (Bituriges), Durocortorum = Reims (Rèmes), Lemonum = Poitiers (Pictons), Lutetia = Paris (Parisii), Samarobriva = Amiens (Ambiens). Deux localités ont totalement changé de nom: Cenabum = Orléans, Portus Itius = Boulogne. Treize localités, soit près de la moitié, font l'objet de discussions au sujet de leur emplacement et, parmi elles, Alésia.
La deuxième remarque concerne le nom même d'Alésia.
Les meilleurs spécialistes estiment qu'il s'agit d'un mot celtique qui signifie "hauteur escarpée". Le radical -al est dérivé de la racine indo-eureopéenne -pal, la chute du p initial indo-européen étant de règle dans les langues celtiques. Le correspondant germanique est postulé par l'ancien haut-allemand felisa, d'où vient l'allemand fels, "rocher". Alésia serait ainsi un nom de lieu aussi banal que celui de Kef en Afrique du Nord où il y a partout des Kef. Aussi César a-t-il pris la précaution de la distinguer en l'appelant Alesia Mandubiorum, le "Kef" des Mandubiens.
Le site d'Alésia peut aussi bien avoir conservé son nom que l'avoir perdu, comme s'est perdu le nom des Mandubiens. La question ne peut être tranchée que par une enquête assez serrée pour ne rien laisser passer à travers les mailles de son réseau.
![]()
La méthode du portrait-robot s'adapte parfaitement à une telle recherche; si elle aide les policiers à découvrir un visage dans la foule, elle permet également de retrouver une certaine configuration géographique dans le moutonnement des collines.
Il fallait d'abord réunir toutes les composantes. La liste, d'après César, principal témoin, a été publiée par A.Wartelle; elle comporte 4O numéros dont I8 "topographiques", 14 "tactiques" et 8 "stratégiques". En première démarche, seules les composantes topographiques devaient être retenues, les autres composantes, tactiques et stratégiques, ne devaient être évoquées qu'ensuite, à titre de confirmation. C'est un "visage", non un "comportement" qui devait être restitué en premier lieu.
Trois opérations étaient nécessaires:
- le recensement des traits signalétiques,
- leur caractérisation,
- leur montage confié à un dessinateur.
Pour le recensement, six unités topographiques principales étaient à prendre en considération: une colline centrale, la ceinture de cette colline, deux flumina, une plaine, une colline extérieure et septentrionale.
La hauteur centrale
La colline centrale est celle qui fut occupée par Vercingétorix après son échec dans le combat préliminaire de cavalerie. Cette colline, sur laquelle vivaient les habitants d'une ville, urbs, appelée Alésia, put recevoir quatre-vingtmille fantassins gaulois et plusieurs milliers de cavaliers rescapés du combat. Elle avait accueilli des réfugiés mandubiens et on y avait fait entrer de nombreux troupeaux pour un ravitaillement capable d'assurer la subsistance de ces milliers de soldats et de civils pendant un long mois. C'est dire que la colline devait offrir une surface en rapport avec cette masse. A moins d'admettre que Vercingétorix ait délibérément voulu un entassement de type "bidonville", on est plutôt fondé à croire que le chef gaulois, qui avait choisi cette colline dans un but stratégique, avait mesuré sa capacité de servir de grande place d'armes. En spécifiant que la contrevallation qui devait serrer la colline au plus près s'étendait sur 11000 pas, chiffre donné par la majorité des manuscrits, soit sur seize kilomètres et demi, César impose la réalité d'un périmètre engendrant une surface en accord avec un camp de retranchement, et non pas rétrécie à la mesure d'un camp de concentration.
Pour visualiser une surface en accord avec la longueur de la contrevallation, l'existence d'une ville et le stationnement d'une armée, le dessinateur trace un carré. Cette surface peut aussi bien s'inscrire dans un cercle, dans un triangle, dans un losange, dans un rectangle. Dans l'éventail des formes, le carré est choisi comme étant la figure la plus neutre. L'évaluation approximative des dimensions est fondée sur deux critères.
Le premier critère est le périmètre de la contrevallation. L'"entouré" étant plus petit que l'"entourant", il convient d'attribuer à la place assiégée un périmètre plus court que celui du blocus, lequel renseigne toutefois sur l'importance de ladite place.
Le second critère est l'espace vital. Quand on fait les calculs en tenant compte des normes des campements pour l'armée, des statistiques de topographie sociale pour l'habitat, en ne négligeant ni les terrains nécessaires au parcage des troupeaux et au stockage des vivres et du matériel, ni les aires sacrées où s'élevaient les sanctuaires, on obtient toujours un chiffre de plusieurs centaines d'hectares pour la position occupée par Vercingétorix. Il est évident que si César n'avait eu à envelopper qu'un mamelon de 100 à 200 hectares, il n'aurait pas eu besoin d'une ligne aussi longue que celle qu'il indique.
Conformément à ces deux critères, le carré de première vision est construit à l'échelle de douze kilomètres pour le périmètre, longueur inférieure de plus du quart à celle de la contrevallation de seize kilomètres et demi. En corollaire, chaque côté du carré prend la mesure de trois kilomètres, couvrant une superficie de neufkilpmètres carrés, soit 900 hectares (Fig. 1).
La ceinture de collines
La colline centrale n'est pas isolée. Elle est entourée par des collines qui lui font une ceinture: colles cingebant. Le verbe cingere est très expressif et signifie "ceindre" comme une couronne ceint un front. Deux expressions caractérisent cette ceinture.
La première de ces expressions, pari altitudinis fastigio se rapporte aux rebords des collines de la ceinture face à la colline centrale. Le mot fastigium peut signifier aussi bien le faîte d'un édifice, la paroi d'un fossé, l'inclinaison de pieux ou de poutres. Appliqué à un relief, fastigium indique une déclivité qui exclut des talus convexes. Une colline qui s'élève en sommet pointu est dite collis in acutum cacumen fastigatus.
La deuxième expression, mediocri spatio interiecto, s'applique à l'espace interposé entre les collines de la ceinture et la colline centrale. Cet espace est faible, mediocri spatio.
Apprécier avec exactitude la valeur des termes employés par César est affaire de topographes. L'un d'eux se recommande à l'attention, c'est le Capitaine Gallotti, officier de l'armée du Second Empire, dont le jugement mérite d'être retenu. Voici comment il restitue le paysage: "La description de César parle aux yeux presque aussi complètement qu'une carte topographique. Les collines voisines de celle qui supportait l'oppidum et qui l'égalaient en hauteur faisaient partie, avec elle, d'un même plateau découpé par des ravins étroits. Les collines devaient présenter des flancs de même inclinaison que ceux qui rendaient l'oppidum imprenable d'assaut, et, conséquemment, elles entouraient la colline centrale d'un cercle aussi infranchissable pour les Gaulois que l'était celle-ci pour les Romains".
On voit l'importance donnée à l'expression médiocri spatio interiecto pour poser l'image de "ravins étroits" et la compréhension du mot fastigium pour restituer à ces ravins des flancs de même inclinaison que ceux de la colline centrale. Et ces flancs étaient rudes. Du côté de la "ceinture" ils offraient des praerupta, c'est à dire des escarpements, et la colline centrale était elle-même admodum edito loco, expression que E. de Saint-Denis a justement rendue par "bien saillante", ce qui s'accorde avec l'expression "en sorte qu'il semblait impossible de s'en emparer autrement que par un siège en règle. Ce qui justifie de donner au mot admodum un sens superlatif, c'est l'emploi par César du mot paululum lorsqu'il dépeint une colline qui n'est que quelque peu saillante: is collis paululum ex planitie editus. Admodum, "tout à fait", s'oppose à paululum, "quelque peu", et dans admodum edito loco, lieu tout à fait saillant, il y a comme un choc des mots exprimant une brusque surrection.
Les flumina
L'expertise des topographes, dont le capitaine Gallotti est un bon représentant, laisse entendre que c'est dans des "ravins étroits" qu'il faut faire passer les flumina. Le mot subluebant ne s'y oppose pas, bien au contraire; il précise que les flumina venaient "laver en dessous" le pied, radices, de la colline centrale, ce qui s'explique si les eaux sont canalisées dans des gorges. L'historien latin Florus, dont on reconnaît qu'il avait résumé Tite Live, l'avait ainsi compris en parlant des rives abruptes: abruptis ripis. Il y a assez de notations concrètes pour saisir quelle réalité géographique est évoquée. Il s'agit de deux vallées en gorges où les deux flumina coulent entre deux versants escarpés. Suivant un terme employé par les géographes, ce sont des "rivières vigoureuses" qui ont approfondi leur lit et qui concourent par là à la défense de la colline. Ce caractère s'accorde avec la dénomination de flumina.
César, en effet, n'utilise pas le mot flumen pour désigner n'importe quel cours d'eau. En dressant la liste des flumina mentionnés dans les Commentaires, on voit qu'ils se répartissent en trois catégories. Il y a d'abord les fleuves, suivant l'actuelle nomenclature géographique: Garonne, Loire, Rhin, Seine, Tamise, Rhône. Il y a les grandes rivières: Aisne, Allier, Doubs, Escaut, Marne, Sambre, Saône. A la troisème catégorie appartiennent des flumina dont le nom n'est pas précisé et qui sont au nombre de cinq: le flumen des Trévires, le flumen qui, avec les marais, entoure Avaricum. Les trois autres sont reliés à la bataille d'Alésia: un flumen prend place dans le champ de bataille du combat préliminaire de cavalerie et deux flumina bordent la collis d'Alésia. Dans ces cinq cas les flumina ont une importance militaire. Le flumen des Trévires "aux rives escarpées" est difficile à franchir, difficili transitu; le flumen d'Avaricum (l'Yèvre, qui se divise en plusieurs bras) contribue avec les marais à la protection de la ville; de même, les deux flumina d'Alésia font partie des défenses naturelles de l'oppidum ; enfin le flumen du combat préliminaire de cavalerie est une rivière derrière laquelle Vercingétorix avait pris position avec son infanterie qu'il voulait soustraire à une entrée trop précipitée dans la bataille.
César emploi un second mot pour la désignation d'un cours d'eau, c'est rivus, qui définit un ruisseau. Un rivus est mentionné au cours de la campagne contre les Nerviens: il ne pose pas de problème de franchissement, progressus trans vallem et rivum: la progression se fait sans difficulté.
René Potier, dans son annexe "Flumen et rivus chez César", a donné cette définition du flumen:"Un cours d'eau est appelé flumen s'il est large, profond ou rapide; autrement dit, s'il présente un obstacle tel qu'il oblige le général à prendre des mesures particulières". Ce ne sont pas des rivi qui bordent l'oppidum d'Alésia.
Le dessinateur place donc les flumina de part et d'autre du carré d'abord tracé, et marque leur écoulement dans des gorges (Fig. 2).
La plaine
Si les deux flumina qui baignaient sur deux côtés le pied de l'oppidum d'Alésia avaient maintenu leur cours parallèlement après avoir longé l'oppidum, la plaine dans laquelle ils entraient aurait dû être assez large pour permettre leur double écoulement. Or, par la triple précision donnée par César que cette plaine n'a que 3000 pas de longueur, qu'elle est enclavée entre les collines, intermissam collibus, et assez dégagée pour permettre le combat de cavalerie engagé par l'armée de secours, elle nous est représentée comme une dépression allongée, soit une combe, soit un val. Ainsi décrite, elle convient plutôt au bassin de réception d'un seul cours d'eau formé du confluent des deux rivières. Un tel confluent fait surgir au débouché des deux vallées en gorges une avancée en pointe suivant un mécanisme de modelé qui se retrouve fréquemment en pays de montagne.
Un éperon vraisemblable et des flumina qui, allant à la rencontre l'un de l'autre, suivent un tracé oblique, invitent maintenant le dessinateur à retenir l'idée d'une pointe triangulaire.
L'éperon barré
Face à l'ouverture d'une vallée, un éperon se dresse semblable à l'étrave d'un navire, mais la fortification naturelle qui paraît si impressionnante vue d'en bas, peut n'être que le rebord d'un plateau, espace vulnérable qu'il faut barrer à moins que la nature ne s'en charge. C'est toute l'aventure de l'"éperon barré".
Les unités topographiques inventoriées proposent une certaine image de la position jugée par César imprenable d'assaut. Les défenses naturelles sont assurées: en avant par un éperon; sur les côtés par des gorges; en arrière, par une protection formant le barrage de l'éperon. Une figure losangée peut sans doute être imaginée. Mais si l'on retient le fait que les flumina se dirigent l'un et l'autre vers une plaine étroite, on est conduit à supposer qu'en amont ils s'écartent progressivement en élargissant le plateau de l'oppidum. Il faut aussi tenir compte des collines qui, du côté opposé à l'éperon, font partie de l'entourage. Car César dit bien que hormis la plaine qui s'étendait en avant, ante id oppidum, la ceinture était complète: reliquis ex omnibus partibus colles cingebant.
Le dessinateur représente schématiquement cette configuration en transformant son carré en triangle, en marquant à faible distance la ceinture des collines et en situant en avant, ante, la plaine de 3000 pas "enclavée entre les collines" (Fig.3). Pour rester dans les normes du carré initial, deux figurations sont possibles. En conservant le périmètre de douze kilomètres, la superficie du triangle avec quatre kilomètres donnés à chaque côté, s'amoindrit à 700 hectares. En maintenant la superficie de 900 hectares, le périmètre, avec quatre kilomètres et demi pour chaque côté du triangle s'allonge à treize kilomètres.
La colline au nord
Le schéma peut être orienté en tenant compte de la colline extérieure que César place exactement au septentrion, a septentrionibus, colline que les légionnaires n'avaient pu comprendre dans les lignes à cause de l'importance de son pourtour: propter magnitudinem circuitus. César n'aurait pas dit de la plaine qu'elle était en avant de l'oppidum, ante id oppidum, si ce n'était pas par la plaine qu'il avait abordé la position gauloise et qu'il avait découvert l'obstacle dressé devant lui. On ne peut pas situer cette plaine au Sud, auquel cas César aurait dépassé l'objectif, et, comme on ne peut pas non plus la mettre au Nord, où il convient de placer la colline septentrionale, la plus grande probabilité est d'envisager que la plaine s'étendait soit au Nord-Est, soit au Nord-Ouest.
La colline Nord n'est pas seulement définie par son orientation et son vaste périmètre. Elle répond aussi à une situation qui la met au centre de la bataille finale. Elle domine un terrain en légère pente: iniquo loco et leniter decliui, qui est l'endroit vulnérable par excellence, choisi par les chefs de l'armée de secours comme objectif pour la dernière attaque.
Après avoir marqué l'emplacement au Nord de la colline septentrionale, le dessinateur fait basculer le schéma de part et d'autre de cette colline pour tenir compte des deux situations possibles de la plaine (Fig.4).
![]()
C'est avec cette esquisse que la recherche sur carte a été entreprise. L'opération nécessitait l'assemblage sur un vaste panneau des feuilles de la carte d'Etat-Major au 1:50000e couvrant une surface de la Gaule telle qu'il était impossible qu'Alésia ne s'y trouvât point. Le vaste quadrilatère ainsi découpé s'étendait de Montbard à Montbéliard au Nord et de Vienne à Chambéry au Sud.
La confrontation de l'esquisse avec la carte fut menée avec lenteur et par carreaux de vingt kilomètres de côté, en allant de haut en bas et de gauche à droite. Il fallait en effet faire abstraction du réseau routier qui aurait porté à des préférences. L'enjeu était essentiellement de voir si dans les accidents du relief la coïncidence avec le portrait-robot pouvait éventuellement se produire.
![]()
Le premier carreau renfermait Alise-Sainte-Reine. Il apparut aussitôt qu'il y avait une nette discordance entre le Mont-Auxois et le portrait-robot d'Alésia. Pas de montagne Nord, mais à sa place la vallée du Rabutin. Pas de plaine enclavée entre des collines et limitée à quatre kilomètres et demi (3000 pas) dans sa longueur, mais l'immense étendue des Laumes. Pas de flumina venant laver le pied de l'oppidum et contribuer à sa défense, mais deux petites cours d'eau coulant tranquillement dans leur vallée respective. Pas de place pour 80000 guerriers sur le plateau, à moins d'un camp de concentration, et pas de citadelle. A côté de ces lacunes, il y avait un surplus embarrassant, le Pennevelle, qui aurait obligatoirement joué un rôle essentiel si Vercingétorix avait organisé là sa résistance. Car le mont Auxois n'est que la partie extrême d'un plateau-couloir de près de trente kilomètres de longueur qui vient s'encastrer non loin du mont Tasselot dans la barrière montagneuse de 500 à 600 mètres d'altitude du plateau de Langres.
Alise-Sainte-Reine ne pouvant être retenue, la recherche devait se poursuivre. Nous avons examiné systématiquement tous les lieux qui avaient la moindre apparence de rapprochement avec le portrait-robot en recourant aux photographies aériennes quand cela était nécessaire. Nous avons ainsi étudié plus d'une centaine de sites et ceux-ci étaient particulièrement nombreux dans la Côte d'Or qui offrait un véritable damier de magnifiques oppida. Dans ce relief, Vercingétorix n'aurait eu que l'embarras du choix s'il avait voulu arrêter la marche de l'armée romaine se dirigeant vers la Saône en venant du Nord-Ouest.
Lorsque nous avons abordé le Jura, nous avons rencontré les Alésia comtoises qui s'établissent sur un arc de cercle orienté du Nord-Est au Sud-Ouest et qui sont autant de portes d'entrées de la région montagneuse. Ce sont Ully, Alaise, Salins, Chateau-Chalon, Conliège, Izernore.
Ully a été proposé par A. et G. Gauthier. Entre Ornans et Cléron, la vallée de la Loue s'élargit à deux kilomètres sur une longueur d'environ dix kilomètres. La Loue reçoit sur sa rive gauche des ruisseaux qui ont découpé un plateau pour en isoler trois collines. La colline orientale est celle qui porte le Bois d'Ully, mais la colline centrale de Chaussagne est la plus importante et la plus "militaire" car on y voit les ruines du chateau fort de St-Denis. Ces positions ne verrouillent pas la route qui va de Besançon à Pontarlier.
Alaise, la vieille rivale d'Alise, comprend trois collines, Mouniot, Chateleys, Chataillon, séparées par des combes à pentes très accentuées; elles sont dominées d'une centaine de mètres par le plateau de Fertans. La Conche est un mince rivelet qui coule dans la petite plaine de Myon sans jamais baigner le pied de Mouniot. Le secteur n'est desservi que par des routes secondaires. Quand nous avions étudié le site d'Alaise, nous avions envisagé la possibilité de placer l'oppidum sur le plateau qui domine Sarraz. Nous avons vite renoncé à y reconnaître l'assiette d'Alésia; il manquait en particulier la protection des deux rivières baignant le pied de l'oppidum sur deux côtés et seul le Lison pouvait être un flumen.
Salins possède une plaine en trop et un flumen en moins, car la Vache n'est qu'un ruisselet et la Furieuse ne lèche pas le pied de l'oppidum sur l'un de ses flancs. Les partisans de Salins-Alésia veulent placer l'urbs en bas de la colline à l'emplacement de la ville actuelle, ce qui est en contradiction absolue avec le texte de César. Salins se trouve dans un passage étroit entre deux hauteurs: à l'Ouest, la montagne de St.-André (604 m); à l'Est, la montagne de Belin (584 m). Pour garder ce défiler, l'exigence militaire réclame une installation sur ces deux sommets. Si Vercingétorix avait choisi ce site pour barrer la route aux légions, il ne se serait pas contenté d'occuper la seule montagne de St.-André, mais il aurait réparti son armée sur les deux bords où l'on voit le fort Belin faire face au fort St.-André.
Chateau Chalon est une haute butte admirablement fortifiée par la nature en avant du plateau de l'Heute, mais sa superficie est singulièrement faible, une quarantaine d'hectares seulement.
Face à Conliège, le plateau qui s'étend entre Montaigu et Revigny présente un front naturellement fortifié dont la vue est spectaculaire. Mais cette belle défense est illusoire, car elle ne se répète pas sur l'autre versant.
A Izernore les tenants du site se sont laissé abuser par l'existence de vestiges gallo-romains. Placer là Alésia, c'est la mettre dans une cuvette, comme le malheureux Dien Bien Phu. Pour barrer le seuil de Nantua, il y avait mieux à faire.
![]()
Aucun de ces sites ne s'imposait et nous approchions du Haut Jura. Le noeud des routes qui aboutissent à Champagnole montrait qu'il y avait là un carrefour d'une extrême importance. Entre Champagnole et Syam, nous regardions l'étroit goulet où passent en se chevauchant la départementale 127 et la voie ferrée. Au confluent de la Saine et de la Lemme, à l'endroit où la plaine de Syam aurait pu s'allonger, elle nous est apparue obstruée par une imposante masse montagneuse dressant un mur presque vertical de 250 m de hauteur. Un site privilégié se détachait tout à coup sur la carte et s'isolait de lui-même. Nous avions devant les yeux un saisissant éperon barré, barré par une suite de collines parfaitement alignées et formant un puissant mur naturel. Cette position était protégée sur ses deux flancs par deux rivières, la Saine et la Lemme dont les gorges créaient de gigantesques douves. En avant s'étendait la petite vallée de Syam. Quant à la montagne Nord, elle était exacte au rendez-vous.
![]()
Cette reconnaissance d'un "visage" réclamait toute une série de vérifications. Les mesures d'abord. Le périmètre de quinze kilomètres de l'oppidum était inférieur à la longueur de la contrevallation: la petite vallée de Syam était enclavée entre des collines et se développait exactement sur quatre kilomètres et demi dans sa longueur. La montagne Nord, extérieurement massive, mais creusée intérieurement d'un thalweg, était comme prédestinée à recevoir les 60000 hommes du corps d'assaut de Vercassivellaunos. Elle dominait une prairie en légère pente, origine d'un col qui était bien un endroit particulièrement vulnérable dans la complexité du relief.
Où étions-nous dans le cadre régional? Dans un site perdu du Jura, sans importance stratégique et en dehors des grandes voies de communication?
La position coiffait la Nationale5, la Route Blanche, celle menant à Genève. Toutes les voies confluaient si bien au Nord que la traversée de l'oppidum était déjà un passage obligé, avant même le col du Morbier. La position barrait la ligne de retraite Langres-Genève, telle qu'elle est déterminée par l'analyse objective du passage où César précise son axe de marche, objectivité régulièrement laissée de côté par ceux qui négligent de parti pris les textes parallèles de Plutarque et de Dion Cassius et qui ne tiennent aucun compte des impératifs militaires qui président à la retraite d'une grande armée. Ce n'était pas une "route plus facile", puisqu'elle atteignait un secteur montagneux, mais c'était un cheminement qui, comme le note César, permettait de gagner plus facilement, facilius, la Province. Plus facilement que quoi? On comprend que la réussite d'une manoeuvre en retraite exige un itinéraire dégagé, sur lequelle on pense que l'ennemi ne se trouvera pas installé en force pour le couper en un point donné.
Ce que nous venons de relater se rapporte au moment où nous avons vu le portrait-robot coïncider avec un site. Rappelons que nous avions devant les yeux un panneau de 5mx5m, où étaient placardé l'assemblage des feuilles de la carte d'Etat Major au 1:50000e. Sur la vaste surface qui se présentait dans l'enchevêtrement du relief, il n'était pas évident que la coïncidence pût se produire. Or, à notre plus grande surprise, l'évènement était là. Le grand éperon barré de la Chaux des Crotenay sortait de son incognito. Il n'avait attiré l'attention de personne. On ne le saisit avec son environnement que sur carte ou sur photographie aérienne. Le touriste ne le voit pas: il passe dans des fonds, n'a jamais de recul et la configuration des lieux lui échappe. Nous avons dû reconnaître plus tard qu'il avait toutefois été remarqué par les géographes, car il est représenté pour la singularité de sa forme triangulaire dans l'Atlas aérien de la France, où il figure en pleine page. En revanche, il avait échappé à la curiosité du Service des Antiquités de Franche-Comté au point qu'il avait été étiqueté "archéologiquement nul". Or, non seulement nous y avions découvert le cadre topographique où l'on peut mettre en place les différents épisodes des combats d'Alésia, mais encore, dans la mesure où nous avons pu faire des fouilles ou des sondages, nous avons pu dresser un inventaire de nombreux vestiges archéologiques.
Nous pouvons dès maintenant présenter un dossier largement positif.
![]()
Disons pour finir que l'expérience que nous avons décrite a eu pour siège le Musée de Constantine, il y a maintenant un peu plus de vingt ans. On ne saurait donc nous reprocher l'esprit de clocher, puisque nous ne connaissions pas le Jura. Nous n'avons pas davantage été guidé par l'esprit d'opposition, car notre recherche en son temps n'avait été entreprise qu'à titre de diversion au milieu de journées tragiques.
Si l'idée nous est venue alors de nous intéresser à Alésia, c'est qu'un doute s'était instauré dans notre esprit. Avant que l'avion ne fût devenu le mode de transport habituel, nous avions fait maintes fois en chemin de fer le trajet Marseille-Paris. Nous avons toujours été étonné, en abordant le bassin parisien, de découvrir, inattendue et émergeant de la verdure, la statue de Vercingétorix. Pourquoi celle-ci sur un simple mamelon après des hauteurs aperçues auparavant et qui, elles, donnaient une impression de force? Pourquoi cet emplacement alors qu'à une trentaine de kilomètres un relief plus puissant offrait, aux approches de Dijon, des possibilités stratégiques et tactiques bien supérieures? Nous ressentions celà confusément et avec une certaine indifférence. Pourtant nous revenait à la mémoire le jugement exprimé par Montaigne dans ses Essais: "L'autre point, qui semble estre contraire à l'usage et à la raison de la guerre, c'est que Vercingétorix, qui estoit nommé chef et général de toutes les parties des Gaules révoltées, print party de s'aller enfermer dans l'Alexia. Car celui qui commande à tout un pays ne se doit jamais engager qu'au cas de cette extrêmité qu'il y alât de sa dernière place et qu'il n'y eût rien plus à espérer qu'en la déffence d'icelle, autrement il se doit tenir libre, pour avoir moyen de pourvoir en général à toutes les parties de son gouvernement".
En 1958, nous avions reçu le livre de J. Carcopino, Alésia et les ruses de César. Nous avons d'abord pensé que, traitée par un maître incomparable, la question allait être définitivement tranchée. Après avoir lu cet ouvrage d'une seule traite, nous n'avons pu retenir cette exclamation: comment! le dossier vient d'être plaidé par un prince de la science et il n'est pas plus convaincant! La démonstration n'a été conduite à son terme qu'en faisant l'impasse sur les Séquanes et en rabaissant à son plus bas niveau les capacités militaires de Vercingétorix!
D'un tel jugement, on pouvait faire appel.
![]()
Notre découverte nous a apporté le réconfort d'amitiés et de collaborations précieuses. Une équipe s'est formée, comprenant des universitaires, des ingénieurs, des officiers supérieurs et généraux de l'ensemble des armes, sans compter de nombreux jeunes qui n'auraient pas tant de dévouement et d'enthousiasme si le site était sans valeur archéologique.
Tous ceux qui ont bien voulu venir travailler sur les lieux ont été récompensés par ce qu'ils ont vu et par ce qu'ils ont trouvé. Ils pensaient d'abord à la ville qui s'est appelée Alésia et ils ont découvert, sur le plateau sommital, in colle summo, de Chaux des Crotenay, un mur d'enceinte de caractère "cyclopéen". Et ce mur d'enceinte, dans son développement à l'Est et au Nord, et bordé extérieurement par une impressionnante suite de monuments en pierres sèches disposés en groupements reliés entre eux par une très ancienne voie retrouvée sous les ronces ou sous l'herbe des pâturages. Cette voie inconnue des gens du pays et qui n'a manifestement aucune fonction économique se présente comme une voie sacrée. Serait-ce une voie de pélerinages, conférant au site une importance religieuse exceptionnelle? Diodore de Sicile ne dit-il pas qu'Alésia était le foyer et la métropole de toute la Celtique?
Les vestiges militaires étaient les plus attendus. La position vulnérable attaquée par les troupes de Vercassivellaunos se repèrait facilement sur les cartes au Sud de la Côte Poire, a septentrionibus collis, où un col s'étend sur deux kilomètres. Ce col a été barré dans toute sa longueur par un puissant système fortifié basé sur une géniale utilisation du terrain. Là, on comprend que les Romains, qui luttaient à un contre cinq, ont pu opposer une résistance permettant l'arrivée des renforts. Ce système fortifié est daté par de très nombreux tessons de céramique antique, tandis que des débris d'armes ont été recueillis: flèches lourdes et talons de lance. La suite chronologique des tessons va de la fin de la République, époque de César, à la période des Antonins, attestant des campements successifs dans un lieu qui, avec son roc affleurant et son éloignement des routes, n'avait aucune vocation agricole; et si sa situation était très largement en dehors de la zone reconnue d'implantation gallo-romaine, il devait sans doute sa notoriété, malgré son isolement, au souvenir d'un grand événement.
![]()
La conduite de la recherche sur le terrain a été entreprise conformément aux impératifs du portrait-robot. Ce n'est pas en nous promenant ou en prospectant au hasard que nous avons fait des découvertes. C'est en allant directement vers des endroits prédéterminés qui avaient été pointés sur la carte d'après les renseignements donnés par César.
Le grand éperon barré de Chaux-des Crotenay, sorti du relief où il était encastré, grâce à l'emploi d'une méthode graphique, a permis la mise en place cohérente des différentes phases des combats livrés devant Alésia et des vestiges avec éléments de datation ont été découverts. Nous avons aussi retrouvé dans la plaine de Crotenay le théâtre de l'engagement en masse de la cavalerie gauloise, restituant ainsi le site double qui scelle l'emplacement d'Alésia, celui du grand combat préliminaire de cavalerie et celui de l'oppidum assiégé. Couronnant le tout, nous avons pu laver Vercingétorix des accusations insoutenables de piètre général et de possible traître. Vercingétorix sort de cette terre jurassienne grandi et justifié, rétabli dans sa vraie dimension, celle d'un grand chef de guerre, digne adversaire de César.
![]()
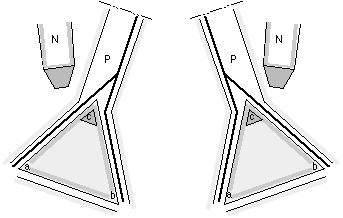
a-b-c : oppidum
c : arx
P : plaine des 3000
pas
N : montagne Nord
![]() Les
publications de l'Institut Vitruve
Les
publications de l'Institut Vitruve